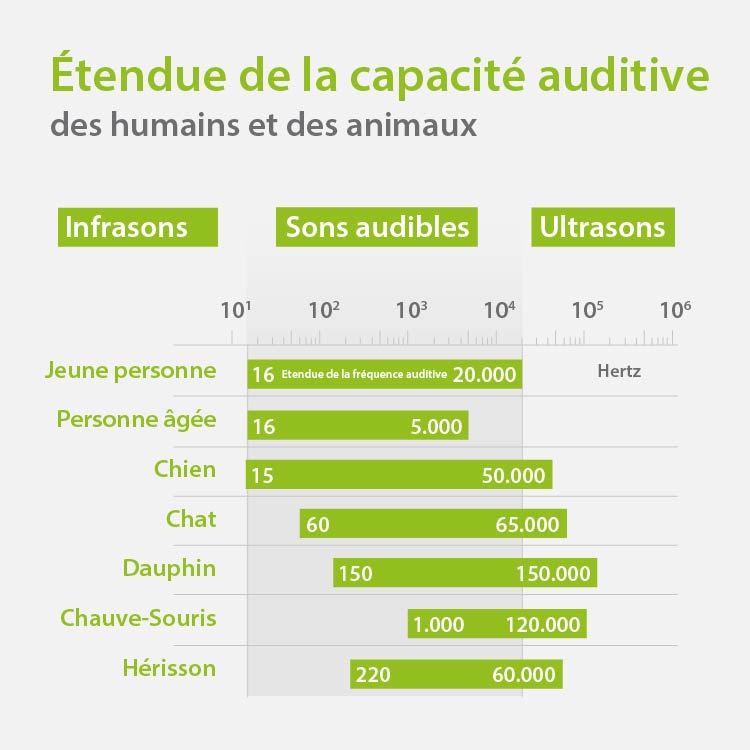appareils auditifs & technologie
appareils auditifs & technologieTania Rodrigues, Audiologist
Sep 16, 2024
Un voyage historique : Les cornets acoustiques et l'évolution des aides auditives
Tout au long de l'histoire, l'homme a cherché des solutions pour améliorer ses capacités auditives et restaurer son audition. Avant l'avènement des aides auditives modernes, les personnes souffrant de déficiences auditives utilisaient divers dispositifs, dont les emblématiques cornets acoustiques, également parfois appelés trompettes auriculaires. Dans cet article, nous nous pencherons sur l'histoire des aides auditives, nous explorerons la fonctionnalité et l'efficacité des cornets acoustiques et nous mettrons en lumière les défis auxquels étaient confrontés les malentendants avant l'invention des appareils auditifs.